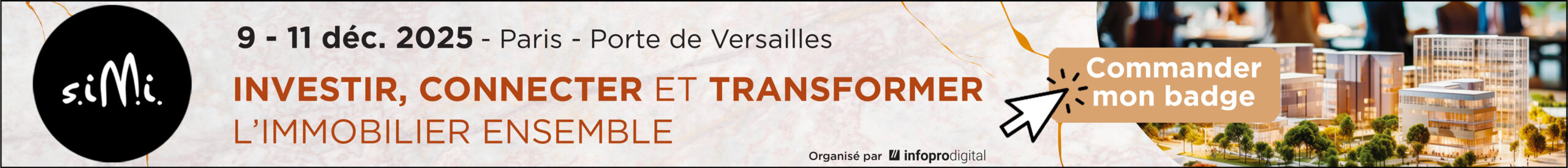Soja ou pas soja ?

Par Allianz Trade
Le marché mondial du soja entre dans une phase de reconfiguration structurelle, portée par une production record, des tensions géopolitiques persistantes et de la relocalisation stratégique des chaînes d’approvisionnement.
Aux États-Unis, le département de l’Agriculture (USDA) prévoit pour la campagne 2025/26 une production record de plus de 130 millions de tonnes, confirmant l’abondance de l’offre. Cette situation, surnommée « Farmageddon », souligne les déséquilibres croissants entre capacités de production, coûts de stockage et demande extérieure. Dans ce contexte, Washington a conclu avec Pékin un accord de reprise partielle des achats : la Chine s’est engagée à importer 12 millions de tonnes de soja américains d’ici la fin de 2025, puis 25 millions de tonnes par an sur les trois prochaines années. Cet engagement vise à stabiliser les échanges bilatéraux, même si le soja américain reste soumis à un droit de douane de 13 %, soit 10 points de plus que celui du Brésil et de l’Argentine.
La Chine demeure le premier importateur mondial avec environ 103 millions de tonnes par an, dont plus de 70 % désormais en provenance du Brésil. Ce dernier consolide sa position dominante, avec une récolte attendue autour de 175 millions de tonnes en 2025 et des exportations dépassant 100 millions de tonnes, pour un revenu estimé à près de 60 milliards USD (soit 2,3 % du PIB). Le dynamisme du commerce extérieur brésilien s’est confirmé en octobre 2025, avec un excédent commercial de 7 milliards USD, en hausse de +70 % sur un an.
L’Argentine bénéficie également d’une récolte en nette amélioration, estimée entre 52 et 55 millions de tonnes, générant 25 à 28 milliards USD de recettes d’exportation. Le soja représente plus de 30 % des exportations totales et environ 7 % des recettes fiscales, offrant au gouvernement Milei une source de financement essentielle dans un contexte de contraintes budgétaires et de négociations avec le FMI.
Dans l’ensemble, la dynamique actuelle illustre un rééquilibrage géo-économique durable : le Brésil s’impose comme fournisseur stratégique de la Chine, l’Argentine exploite sa compétitivité prix pour stabiliser ses finances, tandis que les États-Unis cherchent à préserver leur influence commerciale dans un environnement marqué par la surproduction, la diversification des chaînes d’approvisionnement et la montée en puissance du Sud global.